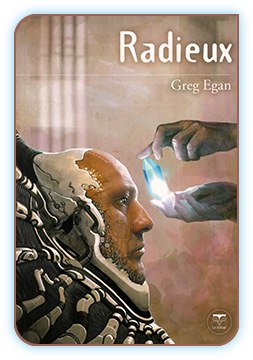Keep Watching the Skies! nº 52, novembre 2005
Ian R. MacLeod : les Îles du soleil
(the Summer isles)
roman de Science-Fiction
→ chercher ce livre sur amazon.fr
À l'extrême fin des années 1940, un professeur d'Histoire, qui ne se sent pas très à sa place à Oxford, et qui vit manifestement fort mal une homosexualité fort peu gaie, et réduite à sa composante la plus mécanique, apprend qu'il est atteint d'un cancer en voie de généralisation. Et face à une mort à laquelle il peine à croire, il part vers le nord de l'Écosse, refaisant l'itinéraire parcouru dans l'été de 1914 avec celui qui fut son seul véritable amour, un jeune homme brillant rencontré dans les milieux de la gauche intellectuelle, volontaire dès que la guerre éclate, et mort ensuite sur la Somme. Tout ceci raconté à la première personne par le personnage principal, sur un ton d'entre mélancolie et distance qui ferait déjà un roman réaliste non négligeable.
Bien entendu, s'il en est question ici, c'est que l'Angleterre décrite diffère fort sensiblement de celle que nous connaissons. Elle a perdu, justement, cette guerre mondiale, dans cet été 1918 où effectivement les choses ont été à deux doigts de basculer. Une partie de ses colonies sont devenues des mandats de la Société des Nations créée à l'issue du conflit. Il y a eu une période de difficultés, des réparations à payer, une crise d'hyper-inflation, des poussées de gauchisme politique ou culturel, une indépendance de toute l'Irlande en 1923, Churchill a été premier ministre mais ne s'en est pas très bien sorti. Oswald Mosley a tenté de redresser le parti travailliste avec une même absence de succès. Et puis un jeune ancien combattant a vu son étoile monter. Son parti, ultra-nationaliste, s'est fait l'écho des peurs, des répulsions, des phantasmes du citoyen moyen, de sa xénophobie, de son antisémitisme, de ses frustrations. D'où des résultats électoraux en progression.
Et un jour, parce que nul de trouvait de solution et qu'il refusait tout autre place, ce John Arthur a été appelé à Downing Street. Le parlement en a disparu, l'incendie de Buckingham a accéléré l'arrivée sur le trône d'Edward VIII et de son épouse américaine. Un effort économique et social a été fait, un effort national aussi et l'Irlande a été reconquise. Par ailleurs, les exercices sportifs collectifs ont été mis à l'honneur, la conscription réinstaurée, une sorte d'ordre de chevalerie, les Chevaliers de Saint George, lié au parti du Premier ministre, l'Alliance Impériale, assure autorité et prestige à ses membres. On peut ajouter que sans que grand monde ne s'en émeuve, une sorte de foyer national juif a été créé tout au nord de l'Écosse, de nouveau, et on a vu quelque temps, aux actualités cinématographiques, des images d'une sorte de rédemption par le travail, avant qu'un silence compact ne tombe. Quant aux homosexuels, ils ont été invités à se faire soigner, sur l'île de Man, selon des méthodes existant d'ailleurs antérieurement, électrochocs et autres joyeusetés — le narrateur a préféré la discrétion. Il n'est pas non plus très bon, par exemple, d'être Indien. Et l'expatriation vaut confiscation des biens. On l'aura compris, avec le mouvement “moderniste”, c'est une variété de nazisme insulaire, à peine soft par rapport à l'hitlérisme d'avant la seconde guerre mondiale, qui s'est imposé. Et la “relation” du narrateur, avec toute sa famille, est embarqué un jour, parce qu'on s'est aperçu que son épouse était juive, et l'avait caché. Inversement, un lien avec le dictateur simplifie considérablement les choses, le passe-droit étant consubstantiel de l'autoritarisme, et il n'y a guère qu'un Irlandais qui y soit personna grata, un prêtre qui plus est, fort alcoolique, mais qui aurait autrefois initié le jeune John Arthur à la boxe. Et le narrateur, le revoilà, doit sa carrière au fait que son nom, à peine déformé, a été cité dans le discours d'investiture du grand homme qui, enfant, aurait été son élève.
Voilà pour le décor, qui relève non pas des flamboyances d'un romantisme noir, mais de la banalité du mal, de l'acceptation du pire par de braves gens ordinaires (comme la voisine de la famille embarquée un jour pour des destinations à peine précisée) et n'en est que plus efficace et plus réaliste. Comme est réaliste le mécanisme menant de la défaite à la dictature, et surtout celui de la conversion psychologique de John Arthur racontée par lui-même, son itinéraire d'ancien combattant défait, la limitation des liens de solidarité à ses camarades de tranchée et la détestation du monde extérieur et non du seul ennemi, et l'illustration de la théorie de la brutalisation des sociétés quand il dit : « La guerre n'était pas finie […] les soldats comme moi l'avaient rapportée dans leurs bagages. ».
Reste bien entendu à combiner tout cela. La quatrième de couverture précise que le professeur « détient un terrible secret qui pourrait changer le cours de l'Histoire ». On peut discuter du mot terrible, et même de ce changement du cours de l'Histoire, potentialité plutôt représentée par la volonté du narrateur de mettre à profit son lien avec le dictateur pour assassiner celui-ci. Et on peut trouver artificielle la lenteur avec laquelle l'explication est donnée, à la page 221 seulement — mais c'est qu'on l'attend sur la foi de cette quatrième de couverture, sans laquelle le « terrible secret » semblerait sans doute arriver tout à fait à son heure. Et on ne sentirait sans doute pas l'allongement de la novella originelle au format d'un roman. Tout fonctionne, et dans la qualité. D'où la valeur du roman.
Restent quelques interrogations, ou quelques scories mineures. Elles ne portent guère sur l'idéologie. L'ambiguïté même du dictateur est un élément de la qualité du tout. Il ne semble pas responsable des exactions, des abus, des violences, des horreurs cachées. Il semble déplorer, s'attrister de problème que d'autres résolvent par la manière forte. Mais dans le texte, tout est filtré par la subjectivité du narrateur, dont on ne voit pas pourquoi elle serait rapportée à celle de l'auteur, ni pourquoi elle devrait d'imposer au lecteur. Le fait que le leader cautionne en réalité tout ce qui se passe est une évidence, et le fait d'en faire par ailleurs un être humain n'y change rien — sinon rappeler qu'on ne peut tout mettre au compte d'une monstruosité constitutionnelle ou de quelque satanisme : on retrouve la banalité du mal. Peut-être aurait-il été préférable que le futur dictateur ne finisse pas la guerre comme caporal, ce qui renvoie de manière assez automatique à un certain Adolf Hitler — mais bien des points de la biographie de ce dernier sont loin de se retrouver dans celle de John Arthur. Et ce serait un fort mauvais procès que de reprocher au roman de ne pas calquer fidèlement la situation allemande quand un démarquage trop fidèle serait jugé trop facile — et peu plausible, les substrats et les expériences historico-politqiues antérieures étant bien évidemment assez différentes à Londres et à Berlin. Et puis il est particulièrement intéressant que soit posé le problème non de la responsabilité d'un homme, mais d'une population dans son ensemble…
Le problème, si problème il y a, peut davantage être trouvé dans le tableau général implicite de l'Europe après une victoire allemande en 1918 — on peut se demander par quel mécanisme une Italie vaincue aurait évolué de la même manière que l'Italie victorieuse mais frustrée, et se serait retrouvée avec Mussolini à sa tête. Ou pourquoi une France vaincue n'aurait pas subi les mêmes chocs nationaux et économico-financiers que le Royaume-Uni, aurait été mieux immunisée que lui contre la tentation de la dictature, et se retrouverait avec un gouvernement Léon Blum puis un gouvernement ultra-nationaliste dirigé par un De Gaulle — dont on voit fort mal comment il aurait pu arriver à ces responsabilités sans le désastre de 1940… Ou encore quels seraient les ressorts d'un rapprochement franco-allemand dans ces années 1930. Ce sont des détails, mais ils peuvent gêner — plus en deçà qu'au-delà de la Manche sans nul doute. Mais s'ils peuvent correspondre à une certaine légèreté dans la mise au point globale de l'univers uchronique, ou à une exacerbation de l'insularité qui fait évacuer et globaliser le reste du monde, empire exclu — on trouverait facilement des équivalents franchouillards —, ils sont finalement de peu d'importance face au roman lui-même, à la présence du narrateur, au ton, et aussi à la vision de la dictature, glaçante, terrifiante dans sa banalité, et fort éloignée d'un schématisme justifiant les lâchetés, ou les pulsions, de chacun. Alors tant pis pour ces détails, et même par exemple pour un flottement entre Nations Unies et Société des Nations : c'est l'excellence du reste, de tout le reste, qui prime. On en regretterait que l'ouvrage, avant de se retrouver en poche chez "Folio SF" — une fort bonne chose pour les amateurs — n'ait pas pu connaître une première version grand format dans une collection de littérature générale, pour trouver des lecteurs dans ce secteur, d'autant que des estomacs rétifs à la Science-Fiction ingurgitent semble-t-il sans trop de mal des Histoires imaginaires.