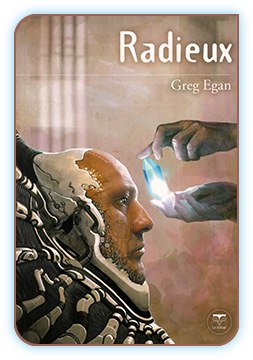Keep Watching the Skies! nº 56, janvier 2007
Michael Bishop : Visages volés
(Stolen faces)
roman de Science-Fiction
→ chercher ce livre sur amazon.fr
"Folio SF" prend de temps en temps le risque de proposer des inédits directement en poche. Parfois même des traductions — coûteuses par la force des choses —, et d'auteurs de qualité mais peu connus du grand public, et a priori pas très vendeurs. Ce qui suppose du courage, des paris sur l'avenir qui sont l'honneur d'un éditeur (c'est tout de même Gallimard : noblesse oblige) et quelques ventes de fond pour éponger le déficit. Cela relève du sacerdoce et mérite des coups de chapeau. Ou relève de la saine gestion à long terme, ce qui est encore plus rare et plus admirable en des temps où l'exigence de rentabilité immédiate engendre quelques retentissants plantages.
De ce que l'on connaît déjà en français de Bishop, Requiem pour Philip K. Dick mériterait une réédition, en poche justement, par transvasement sans doute facile depuis la maison Denoël, et cela pourrait même être rentable sauf si la dignité intellectuelle attribuée à l'auteur éponyme et son statut posthume presque “légitime” sont moins porteurs en termes de ventes qu'on pourrait l'imaginer. C'est en tout cas un fort bon roman. "La Fiancée du singe" est une nouvelle de Fantasy éditée façon small press avant que la Fantasy soit à la mode, traduite par Jean-Daniel Brèque avec son soin bien connu, et illustrée voire enluminée pour en faire un objet remarquable. Le Bassin des cœurs indigo a été chroniqué avec quelques réserves mais aussi beaucoup de chaleur par Philippe Curval dans Galaxie pour les amateurs, et encensé sans lesdites réserves par le même mais pour un plus grand public dans le Monde, à sa sortie chez Lattès en 1977, ce qui ne rajeunira personne. Puis ledit roman est pratiquement passé à la trappe de l'oubli, de façon tout à fait injuste. Et voilà. On a bouclé le tour des “du même auteur”. On peut ajouter le texte matériellement central de la très remarquable anthologie concoctée par Thomas Day, les Continents perdus, "Apartheid, supercordes et Mordecai Thubana", près de cent pages qui justifieraient à elles seules l'achat du volume si les quatre autres textes n'étaient pas de qualité en gros égale, au plus haut. C'est tout ? Ben oui c'est tout, et c'est un peu court pour l'auteur d'une vingtaine de romans, couronné de quelques prix. Comme dit la notice de présentation, dans l'anthologie déjà citée, « Bishop ou l'insuccès immérité ». Ben oui. Il mériterait mieux. Et le lecteur francophone mériterait plus. Alors, quand on en a sous la main, on applaudit. En espérant donner des idées aux autres éditeurs ou au même. Pourvu qu'ils ne soient pas trop regardants sur les chiffres de vente ou qu'iceux se démultiplient : il n'y a aucune raison valable pour réserver ce genre de miracles aux pains et aux poissons.
À propos de Visages volés, on pourrait reprendre en partie de ces choses écrites il y aura bientôt trente ans par Curval à propos d'un autre roman. Quitte à procéder à de menues adaptations. Et à placer quelques bémols, il faut bien l'avouer. Il était question de la rareté des textes où « l'on peut deviner la différence et, derrière le carton-pâte des silhouettes en forme de monstres, voir autre chose qu'une pâle copie de l'homme ». Là, il s'agit d'humains selon toute vraisemblance, et des références précises au passé de la Terre viennent lester l'impression de familiarité, mais le souci de décrire autre chose, d'offrir « une ethnologie imaginaire » est bien présent, comme « la subtilité » pour « réinventer une mentalité différente, pour la confronter à la nôtre, pour en déduire des conflits psychologiques qui ne répondent pas à notre comportement habituel. » On peut reprendre encore d'autres phrases, sur « le lent suspense qui le[s] décrit », sur le livre qui « révèle un écrivain » (avec le recul et la réitération, on peut déplorer qu'amnésies éditoriales aidant, Bishop n'en finisse pas d'être révélé). Et ici aussi « l'analyse politique de la situation d'une minorité opprimée […] peut servir de référence à tant d'autres situations semblables sur Terre. » Les réserves aussi se justifieraient. Pas la trop grande richesse du livre, celui de chez Folio est en fait assez court, relativement dense mais assez loin du point où il risquerait de partir dans tous les sens. Des esprits chafouins pourraient même parler de très longue nouvelle. Mais là aussi les « personnages d'outre-espace [sont] trop fascinants pour qu'il soit aisé de se laisser convaincre par l'anecdote » ce qui revient à dire que le travail sur les personnages, le décor, la situation a un peu gommé l'intrigue… Pas trace non plus, mais on s'en plaindra assez peu, du « soupçon de mysticisme qui brouille les cartes », mais sans doute la présence d'une « pesanteur formelle qui paralyse un peu la pensée et qui empêche ce [livre] d'être un chef-d'œuvre » phrase qui était immédiatement tempérée ainsi : « Qu'importe, c'est déjà une œuvre et le fait n'est pas si fréquent. »
Une fois ces éloges et ces réserves empruntés à Curval, et — on le répète — à propos d'un autre ouvrage, de quoi s'agit-il ici ? Du regard sur une minorité opprimée. Effectivement. Des malades. Atteints d'une sorte de lèpre. Réputés inguérissables, pouvant tout juste relever de rémissions passagères. Misérables et voués de surcroît à des maladies de carence comme la pellagre. Et parqués dans une réserve sur leur planète, où l'homme s'est installé depuis relativement peu de temps et qui est de façon curieuse dotée d'une culture postiche inspirée des Aztèques, certes un peu déplacée sous un climat tempéré plutôt froid mais inspirant nombre d'aspects au moins cosmétiques de la vie quotidienne et des apparences publiques. Le tout enchâssé dans une civilisation interplanétaire conçue pour offrir une sérieuse ressemblance avec la bureaucratie de l'alors (1977, rappelons-le) pas encore feue U.R.S.S., chapeautée par un “Glaktik komm” aujourd'hui un peu plus rétro qu'exotique. Quelques autres notations (une troïka, une planification de la consommation aux résultats pour le moins médiocres) complètent d'ailleurs l'assimilation. La relative familiarité est d'ailleurs quelque peu irritante. Même si au moment où l'on commence à trouver trop peu plausible le collage de choses connues pour composer un monde non daté mais vraisemblablement réputé situé dans un avenir très distant — ou alors, il y a très très longtemps mais dans une galaxie très très lointaine —, on se retrouve avec un détail comme os à ronger ; une hutte à peau “thermotaunome”, un apparatchik en pagne, une autoluge convertible, une discussion impliquant des mœurs à la fois proches des nôtres et pas tout à fait identiques : cela amène certes plus ou moins à reconsidérer les images mentales que l'on s'était construites, mais dans une proportion qui reste tout de même un peu limitée. Tout comme reste fait assez limitée l'exobiologie, malgré les “pequia”, bestioles volumineuses certes hideuses mais plutôt floues, ou quelques amphibiens à deux pattes. Et même le langage déstructuré des malades n'a de valeur que très relative en matière d'extranéité, dans la mesure où les personnages réputés “sains” s'expriment comme nos stricts contemporains. Bref, ce n'est pas du côté du pittoresque exotique que le roman se recommande le plus.
Le personnage principal, “kommissar” né sur une autre planète de la même civilisation galactique, débarque en punition après un accrochage minable avec un supérieur hiérarchique non moins minable. Il découvre progressivement la situation, ce qui aide le lecteur à la découvrir avec lui : vieille ficelle toujours efficace, et contre laquelle nul ne saurait renâcler, tant elle bénéficie au public. En l'occurrence, la découverte est double, les malades, leur langage spécifique, leur organisation, et la société planétaire englobante à l'occasion d'expéditions du personnage principal en ville, infructueuses mais donnant des indications sur la dite société — sinon sur ses toutes ses tares ou tous ses vices du moins sur ses obsessions — et préparant sa découverte de la traduction de celles-ci par les réprouvés. On a affaire en effet non seulement une société de surveillance policière, même si elle reste à peu près vivable et humaine, mais aussi une culture de la mutilation, avec des exercices d'escrime à fleurets non mouchetés dans les couches supérieures, ce qui peut rappeler des pratiques à base de sabre dans le monde estudiantin germanique d'avant 1914 davantage que les cultures de l'Amérique précolombienne, et avec surtout des représentations théâtrales mimant des sacrifices humains, ce qui renvoie directement aux dites cultures. Et le rapport entre religion et mutilation, ou entre adoration et mutilation, se retrouve chez les victimes.
Il devient difficile d'aller plus loin dans le récit sans tout raconter. Ce qui est toujours dommage. mais permet de rendre compte de ce qui fait l'intérêt du récit, c'est-à-dire son ambiguïté. On peut fort légitimement trouver un peu rapide, ou pas assez explicite, la découverte, la conversion, la crise, bref ce qui arrive au kommissar. De fait, cela aurait mérité quelques développements. Ou peut-être cela ne les méritait-il pas et aurait-ce été tirer à la ligne, et tant pis si c'est trop abrupt pour être tout à fait plausible. Et cela ne changerait rien à l'itinéraire proprement dit. Ni au fond de l'affaire. C'est-à-dire au fait que les malades ne le sont pas réellement et qu'il faut bien expliquer d'une autre manière les développements de leur état et la destruction progressive de leur physionomie par ce qui ressemble à une sorte de lèpre. Mais aussi le fait qu'ils ont totalement intériorisé leur avilissement décrété de l'extérieur, d'en haut. Ce qui n'est pas une atténuation de la responsabilité des administrateurs médiocres, des carriéristes égocentriques, des crétins autoritaires et autorisés qui, on s'en aperçoit, savent la vérité (sur la maladie en l'occurrence) mais n'ont aucune envie qu'elle soit avouée peut-être parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'elle le soit. Ni une atténuation de celle des braves gens, dont les jeunes assistants du kommissar, baignant comme tout le monde dans les préjugés de leur société et les épousant sans grand problème face à un témoin étranger qui ne les partage pas. Mais cela interdit le manichéisme simplet. Cela implique que les victimes puissent être des bourreaux, puissent établir entre elles de terrifiants rapports d'oppression, puissent être odieuses, jusqu'à l'assassinat direct ou indirect. Et jusqu'à la mutilation systématique. C'est peut-être ce qui explique qu'au terme de quelques glissements de sens et autres associations d'idées, la quatrième de couverture parle de colonisation. Ou peut-être est-ce parce que le mot est dans l'air du temps, et commode pour expliquer bien des problèmes de la société française dans un autisme nombriliste oublieux entre autres de ce qui peut se passer outre-frontières, par exemple en Allemagne où l'histoire coloniale et migratoire est assez différente de celle de la France. Il n'est d'ailleurs pas impensable d'appliquer le schéma du roman à une situation coloniale — même s'il est peu probable que les ex-colonisés, et ceux qui entendent capitaliser sur leurs drames à des fins de promotion personnelle, trouvent le discours agréable… Reste que le propos est bien plus large. Et franchement désespérant. Ce qui n'est pas une tare.
Cette noirceur de fond, même si elle n'est pas totalement exploitée, ce pessimisme, ce refus de peindre les victimes comme bonnes par principe, tout cela fait sans doute la valeur du roman. Et il me semble que cela peut faire pardonner bien des choses, des maladresses dans l'écriture ou dans la traduction, un excès de rapidité, ou de schématisme, là ou des pages supplémentaires rendraient l'évolution du personnage principale plus claire, plus progressive et pour tout dire plus plausible, etc. Cela dit, tout de même, dans la masse des textes inédits de Bishop, celui-ci n'était peut-être pas le plus urgent à proposer au lecteur français. On ne peut qu'espérer que ce ne soit pas le dernier, que d'autres suivent, édits et inédits, plus aboutis, plus significatifs, plus importants… Parce que l'auteur le vaut bien, durait-on à la télé à l'heure des publicités.