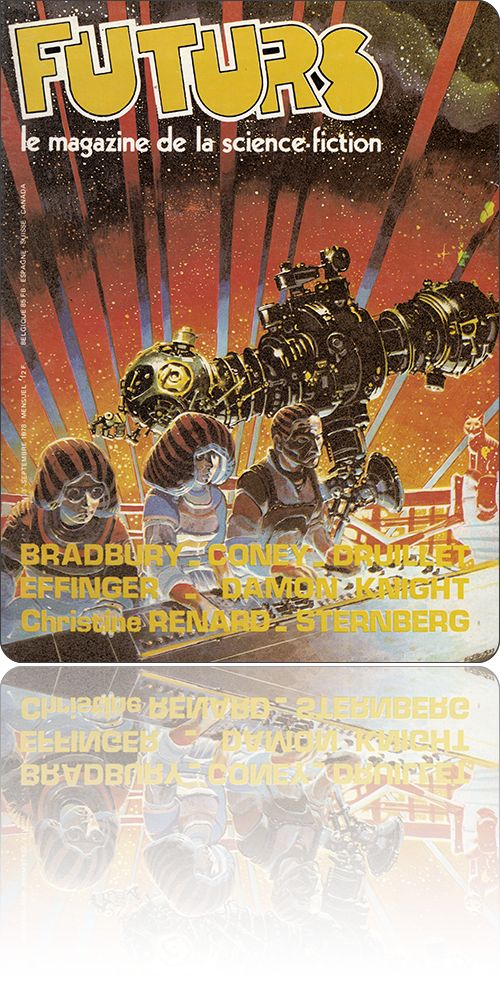Jusqu'au bout et au-delà avec Ray Bradbury
entretien, Paris, 1978
- Philippe Curval : Ray Bradbury, les historiens vous citent parmi les participants de la première convention mondiale de Science-Fiction, en 1939, à New York. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez aujourd'hui de cette manifestation et situer son importance aux USA ?
- Ray Bradbury : je crois, en tout cas, que cette convention a été extrêmement importante pour moi, car j'avais dix-neuf ans, je n'étais absolument pas connu et je n'avais jamais rencontré les grands écrivains qui étaient là. Une réunion comme celle-là, qui permet aux artistes, aux auteurs, aux dessinateurs de se retrouver et d'échanger leurs impressions est, à mon avis, bonne, utile et fructueuse. Il y avait là Edmond Hamilton, Jack Williamson, Leigh Brackett et d'autres ; ils sont tous devenus mes amis et mes maîtres. Et la dette que je leur porte est énorme. À dix-neuf ans, quand on a la chance de rencontrer des écrivains plus mûrs, qui vous admettent dans leur cercle et vous accordent leur amitié, voilà qui donne beaucoup de confiance en soi.
- Quand vous avez publié, dans Planet stories, en 1946, la première nouvelle des Chroniques martiennes, envisagiez-vous déjà le cycle tout entier ?
- Non, pas du tout ; quand j'ai écrit cette nouvelle, je n'avais absolument pas l'idée d'écrire un cycle à partir d'elle. C'est en 1944, en lisant un recueil de nouvelles de Sherwood Anderson, que le projet a sans doute pris naissance. Ce qu'il avait fait m'avait littéralement ébloui et je me suis mis à envisager les Chroniques martiennes à l'image de ce cycle qu'il avait écrit, en plaçant l'œuvre sur Mars. Ensuite, j'ai perdu ce plan ; j'ai bien écrit quelques histoires sur Mars, mais mes notes s'étaient dissoutes et j'avais oublié mon rêve. Je crois cependant que mon subconscient était en train de travailler en souterrain, de collationner et de fusionner toutes ces idées qui m'agitaient et qui m'ont amené plus tard à faire les Chroniques martiennes.
- C'est quelques années après, alors que j'étais sans argent et que ma femme attendait un enfant, que je me suis décidé à aller voir les éditions Doubleday. J'ai essayé de leur vendre quelques-unes de mes nouvelles en recueil ; ils m'ont répondu qu'ils ne publiaient que des romans. Je leur ai affirmé que je n'étais pas un romancier. Ils m'ont dit que j'en étais peut-être un qui s'ignorait ; ils m'ont cité en exemple toutes ces histoires à propos de Mars que j'avais fait paraître dans plusieurs revues et m'ont suggéré de les réunir ensemble, de les lier pour en faire un ouvrage. Ce soir-là, je me suis rendu à l'association des jeunes chrétiens où il était possible de dormir pour une somme modique, je me suis couché, j'ai réfléchi et j'ai bâti le plan. Le lendemain, je suis retourné chez l'éditeur, je leur ai soumis mon projet ; ils l'ont acheté et je suis reparti avec un peu d'argent. Depuis ce jour-là, j'ai un grand respect pour mon subconscient. Lui sait ce qu'il fait, tandis que moi, je vis un peu dans l'ignorance. Alors, je le laisse agir ; ça me réussit bien.
- Pensez-vous être le créateur de cette forme de romans en plusieurs nouvelles liées ensemble qui sont spécifiques dans la Science-Fiction de cette époque ?
- D'une certaine manière, j'en suis un peu le créateur, mais je ne suis pas le seul, j'ai apporté ma touche personnelle. Ainsi quand j'écrivais, au début de ma carrière, des histoires d'hommes qui songeaient à aller sur la Lune ou de femmes qui se désolaient parce que leur mari était astronaute, poursuivant ainsi mon rêve, ces histoires étaient mal reçues par les éditeurs qui disaient qu'elles étaient trop personnelles, qu'elles n'avaient pas de sens si on ne se référait pas à l'ensemble de mes œuvres ; il y a là, je crois, un commencement de preuve : mes premières nouvelles faisaient bien partie d'un roman intérieur dont j'ignorais inconsciemment la totalité. Mais, à mon avis, c'est Robert Heinlein, en 1941, avec "Requiem", qui a écrit le premier récit de ce genre qui devint ensuite l'Homme qui vendit la Lune.
- Ce genre de récit à multiples facettes, qui suggère des mondes différents, est-il, à votre avis, particulièrement bien adapté à la Science-Fiction ?
- Probablement, mais je n'en suis pas sûr. En tant que commentateur et moraliste de mon œuvre, j'ai conscience d'être assez ignorant de la science. Je crois pourtant, profondément qu'une Science-Fiction plus attachée à décrire des machines, à parler de leur utilisation et de la manière de vivre avec elle serait plus en accord avec le problème.
- Votre position philosophique par rapport à la conquête de l'espace a-t-elle évolué entre le moment où vous rêviez de voyages dans les planètes dans vos récits et le moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune ?
- Mon rêve à moi a commencé bien avant, au moment où je lisais les livres de Wells, la Guerre des mondes, les Premiers Hommes sur la Lune. J'avais quinze ans à l'époque et ces histoires me faisaient pleurer d'enthousiasme ; ce sont elles qui m'ont fait désirer parler de la conquête de l'espace.
- Néanmoins, votre attitude à l'égard de la conquête de l'espace est assez critique dans vos premières œuvres ; je voulais savoir si la conquête de la Lune a modifié cette position ?
- Oui, certainement. Avant que tout commence, nous avions extrêmement peur que l'Homme se comporte mal en envahissant un monde qui lui était étranger, comme il l'avait fait bien des fois auparavant. Or, il me semble que tout s'est très bien passé, que nous avons pris le maximum de précautions pour ne pas perturber l'écologie de l'espace. C'est la raison pour laquelle j'ai évolué. Quand j'écrivais les Chroniques martiennes, je n'avais pas l'intention de me comporter en prophète ; je ne suis pas capable de prédire l'avenir, je me contente de prévenir des dangers qui nous guettent. Vous voyez, je considère un peu les romans comme les enfants regardent leurs parents. Si les parents veulent avoir une influence sur leurs enfants, ils ne doivent pas être stricts, ils doivent avoir le sens de l'humour, savoir les intéresser, leur apprendre des choses et surtout les distraire. Comme Jules Verne a été un père très affectueux pour ceux qui le lisent
- Tout au long de votre carrière, vous avez indistinctement publié des œuvres de Fantastique et de Science-Fiction ; estimez-vous qu'il n'y a pas de différence entre les deux genres ?
- Au contraire, il y a une différence énorme, parce que la Science-Fiction joue avec les lois physiques, tandis que le Fantastique rompt avec elles. Seule la morale reste la même. Ce sont deux méthodes d'approche pour parvenir souvent aux mêmes conclusions. Les Chroniques martiennes sont un bon exemple de ce qu'il est possible de faire en mélangeant les genres. Une bonne partie des histoires appartient au Fantastique parce qu'elles ne sauraient se réaliser, d'autres utilisent des lois physiques, la technologie et pourraient se réaliser. Pourtant, elles forment une somme qui n'est pas différenciée dans l'esprit du lecteur, elles aboutissent au même résultat.
- Vous êtes certainement l'un des premiers auteurs contemporains à avoir attiré l'attention du public sur les dangers de la pollution, particulièrement dans l'Homme illustré. Ceux de la génération actuelle se reconnaissent-ils en vous ?
- Oui, sans aucun doute. Mais ceci ne doit pourtant pas être une attitude mentale systématique et je ne souhaite pas qu'on fixe sur moi l'étiquette d'écologiste. C'est trop sérieux. J'ai parlé des dangers de la pollution parce que j'avais en moi l'émotion pour le faire et non parce que je voulais sauver le monde. Peut-être y aurait-il lieu de faire une différence entre l'écologie et les écologistes. L'écologie est une science. Ce que pensent les écologistes dépasse souvent la capacité de cette science et risque de bouleverser l'écologie elle-même. Dernièrement, j'ai passé une journée avec le gouverneur de la Californie, Jerry Brown. Nous avons discuté ensemble d'un grave problème, celui du sauvetage des baleines. D'un côté, j'aime ces animaux ; il n'y a pas longtemps, j'ai survolé l'océan en montgolfière, le ballon frisait les lames, j'étais presque à la hauteur des baleines et le visage de Dieu m'a regardé de face. Donc j'ai une grande sympathie pour cette fantastique espèce de créatures. Par ailleurs, en Alaska et au Canada, de l'autre côté des États-Unis, il y a des Indiens, il y a des Esquimaux qui sont des populations en voie d'extinction. Il est impossible de leur interdire de chasser la baleine sans provoquer leur disparition. Alors, je demande, qui doit-on privilégier, les baleines ou les Esquimaux ? De quelque façon qu'on intervienne, on risque de provoquer la perte de l'un ou de l'autre. C'est un jugement de Salomon. Lorsque les écologistes s'intéressent à ce genre de problèmes, ils prennent des décisions tranchantes qui portent un grave préjudice à l'une des deux parties. Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit possible de décider dans un cas semblable.
- Ne croyez-vous pas cependant qu'à propos des baleines et de leur chasse, il s'agisse d'une industrie nuisible ?
- Ceci est tout à fait ironique, puisque les Indiens et les Esquimaux sont, en partie, industrialisés. Je ne sais pas la décision que va prendre, en dernier ressort, le gouvernement des États-Unis ; de toute façon, cela n'obligera pas les Russes et les Japonais à en faire autant. Voilà le genre d'humour que je n'aime pas.
- L'adaptation en France de Fahrenheit 451 a été événement cinématographique important. Considérez-vous d'une manière générale que la Science-Fiction est un genre facilement adaptable au cinéma ?
- Pour moi, la Science-Fiction est un genre idéalement adaptable pour le cinéma ; car tout ce qui s'occupe de machines s'occupe de métaphores et la métaphore est la nourriture même du cinéma. Du moment que vous fabriquez une métaphore signifiante, il est impossible de l'oublier.
- Et dans le cas de Fahrenheit 451, l'image n'a-t-elle pas placé une sorte d'écran entre la signification de votre livre et le spectateur ?
- Les pompiers de Fahrenheit 451 symbolisent tous les brûleurs de livres depuis le commencement de l'humanité, depuis les Grecs, les Romains, ceux qui brûlèrent la bibliothèque d'Alexandrie, jusqu'à Hitler, jusqu'à nos jours. En revanche, tous ceux qui impriment et diffusent les livres dans mon roman représentent les défenseurs de la culture, ceux qui aiment et estiment la valeur du livre. Une fois que vous avez compris ces deux métaphores, vous ne pouvez oublier mon histoire. C'est pourquoi il m'est impossible de considérer le film de François Truffaut comme un écran. Au contraire, tous ceux qui l'ont vu ont eu la curiosité de lire mon livre, ce qui en a multiplié les ventes. Donc augmenté l'impact de ce que je voulais dire. Je crois que le Fahrenheit 451 de Truffaut est parfaitement réussi ; il est chargé de pointes d'émotion d'une réelle qualité. Quant à la fin, où l'on voit les défenseurs du livre parcourir un paysage de neige, en récitant les chapitres qu'ils aiment et qu'ils défendent, elle est sublime. Je l'ai revue vingt-cinq fois et j'ai, à chaque fois, pleuré d'émotion.
- Y a-t-il eu des rapports entre les auteurs de Science-Fiction et les écrivains de la Beat generation ?
- Incluez-vous, dans votre question, la Rock generation ?
- Naturellement.
- Nous nous sommes rencontrés très souvent ; pour ma part, je connais très bien David Bowie, Ringo Starr, les Beatles et j'ai de fréquents rapports avec eux. Il y a une connivence profonde entre eux et nous. Je suis sûr que beaucoup d'écrivains de S.-F. vous diront la même chose. Par exemple, au moment du Việt Nam, notre action et celle des compositeurs et des chanteurs de rock ont été communes. Dans les universités, elle était confondue. Dernièrement encore, j'ai parlé dans un auditorium, un soir, à San Francisco. Il y avait dix mille personnes pour m'écouter, alors que la salle ne pouvait en contenir que deux mille ; c'est incroyable ce que la S.-F. est bien reçue par la Rock generation !
- Quand vous avez signé, en 1967, la motion contre la guerre au Việt Nam ; pensiez-vous que le rôle de l'écrivain était de s'engager politiquement. Estimez-vous qu'une part de votre œuvre est engagée ?
- C'est en effet ce que j'ai fait, avec une quantité d'autres écrivains. Nous avons envoyé cette motion au président Lyndon Johnson en lui disant que nous ne pourrions plus continuer d'appuyer son action s'il ne changeait pas d'intentions. Mes amis libéraux n'ont pas voulu croire aux résultats de cette motion. Nous avons soutenu la candidature d'Eugene McCarthy et de Robert Kennedy. Un jour, le président Johnson a dit à la télévision qu'il ne se représenterait plus. Je me suis tourné vers mes amis et je leur ai dit : « Vous voyez, le procès démocratique marche, ça fonctionne. ». Pourtant, j'essaye de séparer mon activité littéraire de mon action politique. Ceux qui essayent de faire de la propagande à travers leurs livres courent à un échec. La subtilité est bien plus efficace. Il y a peu de romans qui se déclarent politiques qui ont survécu dans l'Histoire. Les gens n'admettent pas que vous essayiez de former leur opinion directement et autoritairement. Par contre, de temps en temps, tous les quatre ou cinq ans peut-être, je deviens enragé, je me dresse tout seul et je proclame mon opinion. Je ne crois pas du tout qu'il soit bon de se réunir en groupe pour influer sur l'Histoire. Si vous vous exprimez en tant que groupe, vos adversaires disent : « Qui est cette personne à côté de vous ? N'est-ce pas un communiste, ou un fasciste ou un homosexuel ? » et vous perdez de votre force car vous passez votre temps à défendre vos amis au lieu d'attaquer votre ennemi. J'ai jadis appartenu à des groupes ; maintenant, je préfère mener seul mon combat.
- Pour un lecteur peut-être superficiel, ce qui caractérise votre œuvre est une certaine “touche de mélancolie”. Ainsi, dans votre dernier recueil, Bien après minuit, la justifiez-vous comme une lecture passéiste de notre civilisation ou comme une position critique par rapport à notre société ?
- Non, je crois que la mélancolie est l'état d'âme de l'Humanité. Tous les garçons et les filles, en grandissant, se rendent compte que les couchers de soleil ne durent pas éternellement. J'ai écrit un roman, le Vin de l'été, sur la disparition des tramways, la vieillesse d'une grand-mère, la mort d'un vieillard qui est une machine à remonter le temps. J'ai voulu donner l'impression, profondément ressentie par moi, qu'on est toujours au bord d'un ravin, la nuit, et que l'obscurité va monter vers vous et vous engloutir. Les festivités, les jours fériés, les grandes dates nous enseignent ceci. Quand j'avais cinq ans, j'étais au bord d'une pelouse avec mon grand-père. C'était le 4 juillet, il y avait un splendide feu d'artifice. Alors j'ai sangloté ; je sentais que ces lumières, ces fusées qui montaient et retombaient signifiaient la fin de quelque chose, une année qu'on ne reverrait jamais plus. C'est la mort qui rend la vie belle et la liste des choses qu'on a faites, des belles et bonnes choses qu'on a faites est chargée de mélancolie.
- Votre littérature, comme la plupart de celles qui se référent à l'imaginaire, ne privilégie-t-elle pas les rapports entre inconscient et écriture ?
- Tout mon travail, en effet, consiste à amener en surface ce qui croît à l'intérieur de moi-même — je vis de surprise en surprise. Écrire une histoire devrait ressembler à cette fable : il y a une caille dans le buisson ; alors vous pointez votre machine sur le buisson et la caille s'envole dans l'air. Il y a des gens qui veulent avant tout mettre des pensées sous forme d'histoires ; ils raisonnent et ils ratiocinent à ce propos ; tout ce qu'ils font est faux et mensonger. Je crois plutôt qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Ainsi, en moi, il y a deux personnes : celle qui invente et celle qui reçoit les honneurs de l'écrivain. Ce qui est important, c'est de savoir que ce deuxième n'est pas sérieux, sinon vous devenez médiocre ; il faut prendre des risques, ne pas hésiter à plonger dans le précipice. Votre seule chance est alors de voler, si vous avez des ailes.
- Ne croyez-vous pas que l'auteur de Science-Fiction, plus particulièrement sensibilisé à l'emprise de la technologie sur le comportement humain, est plus apte qu'un autre à révéler les nouveaux rapports qui s'établissent entre l'Homme et la société ?
- Sans aucun doute ; nous sommes définis par nos origines génétiques et l'accumulation des faits que nous avons connus depuis notre naissance jusqu'au moment où l'on se met à écrire. C'est le talent de l'écrivain de Science-Fiction d'extraire, grâce à ses caractéristiques génétiques, toutes ces choses qui ont été mises en réserve, sans procéder à une investigation consciente ; c'est son art propre. S'il cherche à s'interroger d'une manière plus rationnelle, il retombe dans les ornières creusées par la politique, la religion ; il est perdu.
- Le travail d'adaptation que vous avez fait pour le cinéma, sur le Moby Dick de Hermann Melville, a-t-il modifié votre optique d'écriture ?
- Une expérience merveilleuse, semblable à celle que j'ai faite, à dix ans, quand j'ai plongé sous la mer à la suite de Jules Verne. Melville ne m'a pas rendu seulement cette âme enfantine, mais il m'a permis de relire la Bible que j'avais délaissée depuis si longtemps ; il m'a redonné le sens de la métaphore. Cela s'est senti dans mes nouvelles au point que la MGM, en 1969, m'a demandé de faire le script pour le Roi des rois. Le résultat final de cette expérience est un roman, celui que j'écris sur Moby Dick dans l'espace. Il s'appelle Leviathan 99 et raconte l'histoire d'une grande comète blanche qui traverserait l'univers. Vous voyez, mon expérience avec Melville a été déterminante, elle a provoqué toute une série de démarches s'emboîtant les unes dans les autres. J'ai aussi écrit en 1971 un essai sur Melville. Des gens qui construisaient le building des États-Unis à la foire de New York l'ont lu et m'ont demandé de concevoir un spectacle sur l'histoire des États-Unis dans ce building ; puis les gens de Walt Disney m'ont demandé d'écrire d'autres scénarios pour des pavillons à construire sur le territoire américain. Aujourd'hui, le gouvernement français m'invite au congrès de Cerisy pour parler de Jules Verne. D'une certaine manière, on peut dire que Melville et Verne ont changé ma vie.
- Que pensez-vous alors de l'opinion de ceux qui affirment que Jules Verne a faussé dès le départ l'image de la Science-Fiction en privilégiant la science par rapport à l'Homme ?
- Il y en a qui disent ça ! mais ce n'est pas vrai ! Toutes les histoires de Jules Verne sont pleines d'humanité. Voyez le Tour du monde en quatre-vingts jours : l'humour, la subtile description des caractères, tout concours à magnifier le courage humain et à justifier l'orgueil qu'on peut avoir à accomplir une œuvre qu'on s'est proposée. Bien sûr, ses héros utilisent la technologie, mais c'est seulement pour parvenir à leurs fins ; ils n'adorent pas la technologie. Voyez, dans l'Île mystérieuse : Jules Verne vous invite à devenir l'un des cinq ou six Robinson Crusoé de son histoire et à voir si vous pouvez, tout seul, vous créer une science propre. Ses héros y parviennent et deviennent leurs propres maîtres, malgré les incroyables forces de la nature qui s'y opposent, c'est une bonne leçon.
- Dire que Jules Verne a privilégié la science, c'est un peu comme si quelqu'un prétendait que le vol sur la Lune est une expérience purement scientifique. Ce qui compte, ce n'est pas que la fusée ait atterri, c'est qu'Armstrong et, avec lui, toute l'Humanité, y ait débarqué. Tout ce que Jules Verne dit, c'est : « nos yeux sont faibles, nos mains sont courtes ; construisons des outils qui nous permettent d'atteindre cent, mille, un million de kilomètres. Il ne s'agit pas de devenir des machines, mais d'obtenir une supra-perception de l'Humanité qui nous amène à voir et à comprendre davantage. »
- Est-ce que le fait d'avoir écrit principalement de la Science-Fiction à vos débuts n'a pas freiné votre carrière. Aux États-Unis, êtes-vous considéré au même titre que les auteurs de littérature générale ?
- Il y a encore des gens qui ont un préjugé contre la Science-Fiction. Et pourtant, il y a beaucoup d'écrivains par le monde qui écrivent des romans sans étiquette qui sont de la Science-Fiction. Michael Crichton, par exemple, a vendu 500 000 exemplaires de la Variété Andromède dans l'édition la plus chère, sans dire que c'était de la Science-Fiction. Le même livre, écrit par Arthur C. Clarke ou Robert Heinlein, paru dans une collection de SF de même prix, n'aurait pas atteint 10 000 exemplaires. Cela prouve simplement que les gens adorent la Science-Fiction mais ne veulent pas l'appeler ainsi.
- Peut-on maintenant aborder vos travaux encours, vos projets ?
- Certainement, il y a d'abord ce Leviathan 99 dont je fais un opéra qui sera présenté à Paris l'année prochaine en première mondiale. J'écris une émission de télévision pour le Smithsonian Institute qui n'est pas de la Science-Fiction mais une histoire de la science et j'écris aussi une “detective story” qui sera dédiée à Dashiel Hammett et à Raymond Chandler, parce qu'une de mes premières amours a été ce que vous appelez ici la "Série noire". C'est un autre domaine où les lecteurs ont toujours marqué leurs préjugés ; pour eux, ce genre de romans est au-dessous de leur dignité. Et cependant, qu'y a-t-il de plus important que le meurtre ? Tous ces crimes que nous commettons dans nos têtes et tous ces assassinats qui se produisent dans le monde n'en portent-ils pas témoignage ? Pour moi, un thriller, quand il a du style, de l'imagination, le sens de l'humour vaut tous les romans du monde.
- Ne croyez-vous pas que ces littératures dites marginales, “detective story” et “Science-Fiction”, marqueront plus notre époque que le reste de la littérature ?
- Tout à fait. Je ne mets pas dans “le reste de la littérature” les classiques anciens, car leurs auteurs participaient à la vie de la société, la décrivaient. Molière paraît parler de choses frivoles ; il nous en dit plus sur la nature humaine que d'autres aujourd'hui jugés plus sérieux. Mark Twain, également, n'a pas bénéficié de la renommée qu'il méritait parce qu'il était considéré comme un amuseur. Mais quand nous regardons actuellement la littérature générale et particulièrement aux États-Unis, elle est complètement vide, elle est incapable de traduire nos préoccupations et de nous dire comment vivre dans notre société. Tout cela au contraire, vous le trouvez dans la “detective story” et la “Science-Fiction”.